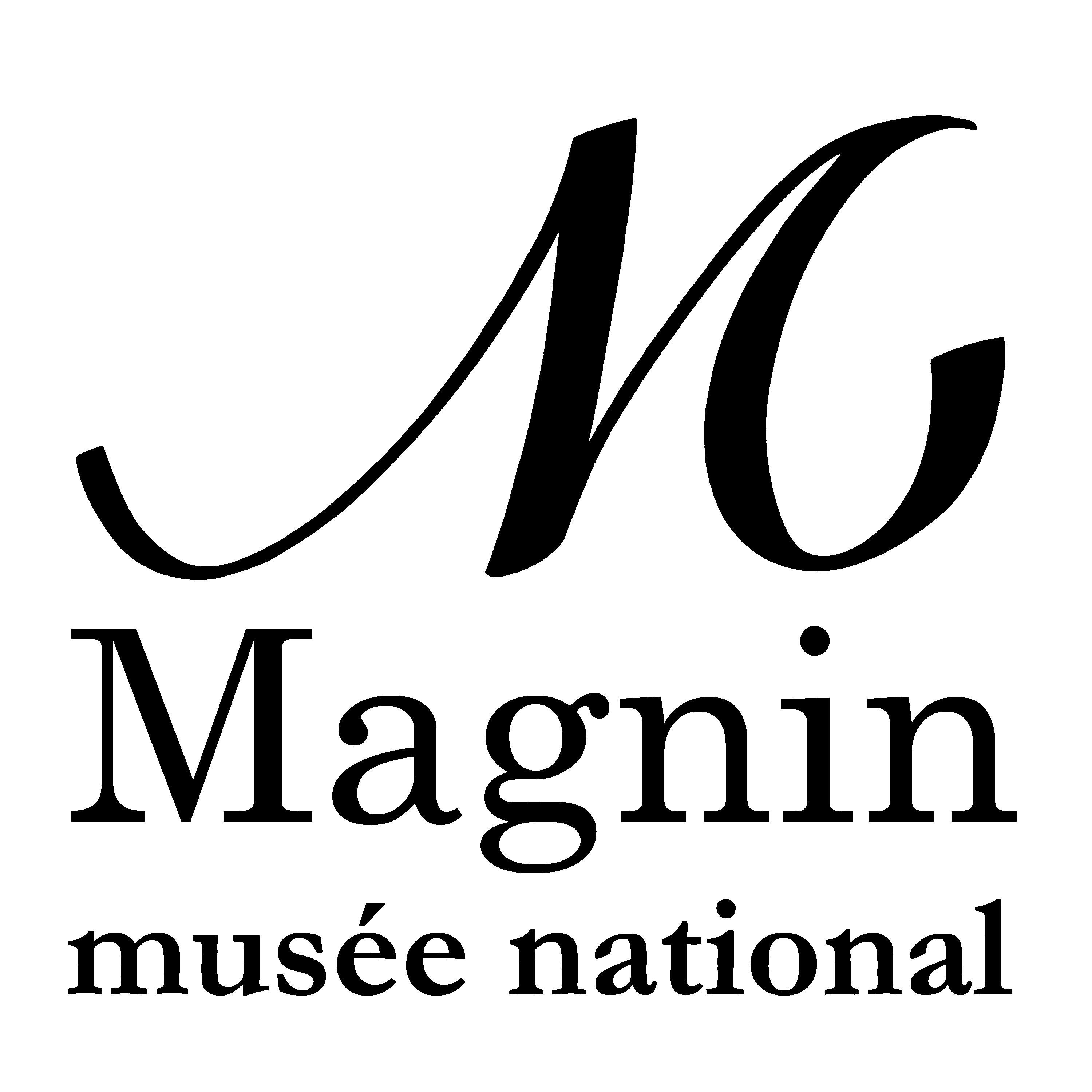Audioguides pour les adultes
Deuxième partie
Pietà

Dans un souci historique, la restauration du tableau de Stefano Danedi, dit Il Montalto, a maintenu les agrandissements des parties supérieure et inférieure, bien qu'ils atténuent sa portée dramatique. Elle a permis de restituer le coloris original, à l'exception du visage à profil perdu de Jean, dont la couche picturale était usée.
Dans les premières œuvres de Montalto, dont cette Pietà fait partie, l'artiste fut marqué – à l'instar d'autres peintres de sa génération – par les grandes figures de la peinture lombarde du début du XVIIe siècle : elle peut être rapprochée du Christ de Procaccini, à l'église Sant' Angelo de Milan ; mais le style ample, les larges plis, l'allongement des bras, rappellent le pathétisme de Morazzone. La parenté la plus étroite est sans doute celle des œuvres de jeunesse de Cairo, contemporain de Montalto, en raison du traitement des visages : formes molles de visages sans relief, largement modelés. Le luminisme caravagesque, le fond noir sur lequel se détachent les figures, l'éclairage blafard projeté sur ces visages modelés d'ombre noires légères desquels se dégagent pathos, sentiment d'abandon mystique et force d'expression douloureuse, constituent d'autres liens de parenté avec Cairo.
Par l'ampleur et le développement des gestes, la rhétorique des attitudes, les courbes et contre-courbes des drapés, cette Déploration est parcourue d'un souffle baroquisant. Le sentiment d'abandon du visage de la Vierge est déjà d'esprit pré-berninesque.
La Bienheureuse Ludovica Albertoni

L'effigie de celle qui consacra sa vie au secours des pauvres du quartier populaire romain de Trastevere, fut exécutée par Le Bernin en 1674, pour l'autel surplombant le caveau de la sainte, sis dans la chapelle familiale de l'église San Francesco a Ripa. L'iconographie est inspirée de la biographie écrite à l'occasion du procès en béatification, qui eut lieu en 1671 : terrassée par la fièvre qui devait l'emporter en 1533, Ludovica trouva réconfort dans l'Eucharistie, en attendant impatiemment la mort pour s'unir au Christ.
À cette époque tardive de sa vie, l'art de Bernin donne dans le pathos. La position des mains, la cambrure du corps, l'agitation du vêtement traduisent les dernières convulsions. La sensation de fluidité d'une matière, la pierre, traditionnellement associée aux surfaces lisses et calmes, évoquant plus volontiers la pérennité que la fébrilité, est typique de l'art éminemment baroque du Bernin.
La sculpture fut assez célèbre pour engendrer copies et réductions. La terre cuite du musée Magnin est conforme au marbre original. Elle a été préparée pour la cuisson, ce qui n'est pas le cas des esquisses d'atelier du Bernin, et une analyse de thermoluminescence a montré que sa cuisson eut lieu avant 1710. D'autre part, elle est conçue comme un ouvrage en ronde bosse : le revers présente un caractère fini. Cette réduction semble donc un objet de délectation autonome, destiné à un amateur. Elle témoigne d'un engouement croissant pour les terres cuites au XVIIIe siècle, et plus encore de la profonde modification du regard sur la sculpture religieuse du XVIIe siècle. On n'y voit plus la mystique vibrante, l'austère leçon de l'art de bien mourir, mais une image sensuelle, ambiguë, qui s'attache à la délectation esthétique, dans un matériau et un format en adéquation avec le caractère intime de ce plaisir.
La Séance de portrait

Cette composition fut chère à Gaspare Traversi, puisqu'on en connaît deux autres versions autographes, à Rouen et à Kansas City.
Traversi a autour de 20 ans lorsqu'il peint ces tableaux, vers 1750, et subit l'influence de Bonito, décelable dans l'aspect caricatural des personnages. Il s'éloigne de la tendance idéalisante de Solimena - le plus grand peintre napolitain du début du XVIIIe siècle – et à l'instar des caravagesques de la première moitié du siècle, se réapproprie la « vérité naturelle ».
On sait également que l'artiste fut attiré par les écrits satiriques d'un dramaturge napolitain, le baron de Liveri, chez qui il puisa peut-être l'ironie mordante, l'humour grinçant de ses personnages. Mais, contrairement à un pan du théâtre italien, on a à faire ici à des visages et non à des masques. Les peintures de Traversi, contemporain de Voltaire et en phase avec les tendances anti-académiques et positivistes de la culture des Lumières à Naples, sont autant d'essais de critique socio-morale : il semble traiter ici des "parvenus", bourgeoisie du sud en formation, rurale ou para-urbaine. Les personnages de Traversi portent ainsi des vêtements qui ne leur appartiennent pas, accomplissent des actes qui ne sont pas ceux de leur condition sociale, se laissent surprendre dans la volonté gauche de s'approprier un genre de vie qui ne leur convient pas mais auquel ils aspirent. D'où le sentiment d'étrangeté que procurent ses tableaux, et dont on se défait en pensant à la caricature. Caricaturiste ou peintre de caractère (La Bruyère n'est pas loin), l'artiste ne pouvait ignorer le fameux traité de Giambattista della Porta sur la physiognomonie, étude systématique de la personnalité à travers la morphologie, notamment du visage.
Dernier surgeon du caravagisme, prophète de l'illuminisme européen, contemporain de Hogarth, Traversi est le peintre de la comédie humaine dont il n'ignore ni les illusions ni la tragique gravité.
Mucius Scaevola et Porsenna

Cette esquisse est préparatoire à l’un des dix Faits de l’histoire romaine peints par le jeune Giambattista Tiepolo vers 1727-28 pour le salon du palais Dolfin à Venise, aujourd’hui dispersés. Le tableau correspondant à notre esquisse est conservé au musée de l’Ermitage (Saint-Pétersbourg). Tirées de l'Abrégé de l'histoire romaine de Florus, ces scènes de sacrifice pour le bien de la patrie, qui faisaient partie du répertoire héroïque de la peinture depuis le XVIe siècle, était souvent traitées dans le cadre de commandes aristocratiques comme exemple de la vertu des princes. Elles convenaient bien à la famille Dolfin, qui avait fidèlement servi la République de Venise.
Florus rapporte les hauts faits de Mucius, général romain pendant les guerres opposant Rome aux Étrusques, au IVe siècle avant J.C. Le général réussit à s’introduire dans le camp des ennemis pour assassiner leur chef, Porsenna. Mais ne le connaissant pas, il tua par méprise un autre homme et fut fait prisonnier. Pour se punir de cette erreur, il mit sa main droite dans un brasier, préparé là pour un sacrifice, et tandis que sa chair se consumait, il annonça solennellement à Porsenna sa défaite prochaine. Celui-ci, impressionné, le laissa partir. Son surnom, « scaevola » signifiant en latin le gaucher, lui fut donné à la suite de cet épisode.
La principale difficulté qui se posait à l'artiste résidait dans la disposition nécessairement verticale de sujets narratifs. Il la résolut par le point de vue légèrement du dessous et l'usage de la diagonale, permettant d'étager la composition. Tiepolo avait organisé l'ensemble en triptyques et le Mucius Scaevola faisait partie des scènes latérales. C'est ce qui explique que le protagoniste apparaisse d'une manière un peu gauche, la tête de petite taille pour laisser la pré-éminence au personnage de la scène principale.
Contrairement à d'autres esquisses peintes peu auparavant, les compositions pour le palais Dolfin ne sont pas relevées de tâches vives sur fond sombre. Ocre, blanc et gris dominent, avec quelques touches de bleu, de vert froid et de rouge profond. Peut-être Tiepolo adopta-t-il cette palette foncée par souci de cohérence avec la dignité solennelle d'un cycle dédié aux héros de la République romaine. La convenance se manifeste également dans les postures rhétoriques des personnages.
La différence la plus sensible entre cette esquisse et la peinture finale réside dans la suppression de la statue colossale de l'arrière-plan. L'artiste ne résistait pas à donner une animation humaine à ces statues ; la suppression contribua à resserrer l'attention sur le noeud dramatique.
L'escalier
Poliphile au bain avec les nymphes

Le Songe de Poliphile, série de huit tableaux - dont celui-ci fait partie - destinés à être exécutés en tapisserie, est la première grande entreprise décorative d'Eustache Le Sueur et s’étend de 1636 à 1644. L’ouvrage de Colonna, célébrissime au XVIe et encore connu au XVIIe siècle, est traité par Le Sueur comme une suite de scènes de fantaisie. Encore loin du style sévère de la maturité, cette œuvre précieuse, épicurienne, teintée d’érotisme, est destinée à un public mondain, pour lequel l’érudition doit céder le pas au romanesque.
Le peintre illustre ici un savoureux passage du roman. Poliphile est convié à prendre le bain par cinq suivantes de la reine Eleuthérilide, qui personnifient les cinq sens : au centre, Aphaé (“ l’attouchement ”) - que Le Sueur a dédoublée pour être plus explicite ; Osphrasie, qui tient le linge et dont la couronne et les fleurs portées par les anges représentent l’odorat ; Orasie, qui présente le miroir, pour la vue ; Acoé, à la lyre (l’ouïe) ; et Geusie (le goût), portant le vase de liqueur.
Le "Manneken Pis" dont Poliphile fait ici les frais, est un thème fréquent dans l’art de la Renaissance. Il donne le ton à cette œuvre plaisante, lumineuse, à la composition souple et aérée, aux coloris pleins de fraîcheur.
La fréquence de la référence à l’architecture dans Le Songe réfère à un art de la mémoire encore vivant dans les esprits au XVIe siècle. De même, les sens traités en allégories sont un souvenir de la Renaissance, pour qui le monde était codé et à déchiffrer. Dans le tableau de Le Sueur, les sens ne paraissent pas avoir de signification ; ils font partie du decorum, au même titre que l’architecture.
La Présentation de la Vierge au Temple

Ce tableau, qui n'a pas le fini d'une œuvre achevée, est sans doute une étude pour un grand retable. Comme dans la plupart des bozzetti de Laurent de La Hyre, la pâte est plus nourrie que dans les tableaux achevés, les attitudes plus pittoresques, les tons plus riches. La lumière fait varier avec subtilité le coloris : La Hyre est un maître de la perspective aérienne, non moins importante à ses yeux que la perspective géométrique. Le décor architectural et le style des figures permet de dater l'œuvre autour de 1647-1648.
Selon des textes chrétiens anciens, Marie, qui devait devenir la mère de Jésus-Christ, avait été conduite par ses parents au Temple de Jérusalem pour y être consacrée à Dieu. De grands peintres ont souvent représenté la scène où la petite fille, quittant sa famille, monte seule les marches du Temple où l'accueille le grand-prêtre. Au XVIIe siècle, on voit volontiers dans cet épisode un symbole de la vocation sacerdotale. Mais son aspect édifiant s'efface ici au profit d'une scène où se côtoient le solennel et le familier.
Les hautes colonnades délimitent avec force un espace étroit mais ouvert à l'arrière-plan. Le rythme imposant de ces masses verticales s'accorde avec les poses nobles des personnages debout, drapés à l'antique. Mais ce n'est pas la perspective en profondeur qui détermine la composition du tableau, c'est la forte oblique de l'escalier, dont le sens symbolique est souligné par le geste du grand-prêtre : incliné vers l'enfant qui vient de quitter sa famille et l'humanité ordinaire, il lui indique la voie vers le monde voué au divin.
La dignité de cet instant solennel s'accompagne d'une émotion discrètement suggérée. Le monde auquel renonce Marie est celui des jeux de l'enfance et de la tendresse maternelle : le groupe des trois bambins et des deux jeunes mères qui encadrent la scène en sont l'image gracieuse alors que sainte Anne, les bras ouverts en signe de don et de foi, laisse partir son enfant.
La Hyre multiplie les figures secondaires et les « commentaires » savoureux, tant avec les sages sérieux, noblement drapés du fond qu'au tout premier plan, le vieillard barbu au livre évoquant, tel un prophète, la Sagesse divine, dont Marie est remplie ou et la jeune femme allaitant son enfant, figure de son destin de mère.
La Sainte Famille

De dimensions modestes, ce tableau était certainement destiné à un cabinet d'amateur. Il date de la période la plus classique de Sébastien Bourdon, les années 1650. Il s'inspire des Saintes Familles de Nicolas Poussin, alors visibles dans différentes collections parisiennes - en particulier la Sainte Famille à l'escalier où les figures, inscrites dans un triangle, sont disposées sur des marches vues en contrebas, dans un décor architectural dont la sévérité est tempérée par des éléments de paysage.
Bourdon choisit de mettre en valeur sainte Élisabeth, vêtue de jaune, qui avec son livre, évoque quelque Sibylle annonçant la mission du Sauveur. La sévérité des lignes droites et des volumes nettement découpés a pu faire parler de " cubisme ". Les blocs de pierre constituent autant de socles pour les figures, à la verticale de la colonne répond celle du palmier, les draperies se découpent en facettes et les personnages sont vus de face ou de profil. Cette rigueur de la composition est néanmoins équilibrée par la fraîcheur du sentiment et l'audacieuse harmonie colorée. L'accord lumineux de bleu et de jaune, tout juste relevé par une note de rouge sur la manche de la Vierge, et certains détails exquis comme la corbeille de fleurs aux pieds de Marie, contribuent encore à rattacher ce chef-d'œuvre à l'atticisme* du milieu du siècle.
Jeanne Magnin : “... Avec S. Bourdon, le groupe si étroitement délié [dans la petite sainte Famille du Louvre de Poussin] se dénoue ; la haute, pure, un peu froide intellectualité cède le pas à une sensibilité frémissante ; la poésie d'un ciel crépusculaire met du rêve autour des âmes, une ombre mystérieuse sur le paysage à palmier et sur le mélancolique saint Joseph blotti contre un fût de colonne. Les derniers rayons du jour, capricieux et furtifs, font doucement luire le beau petit corps de l'Enfant Jésus, effleurent d'une caresse la joue ronde et lisse de la jeune Vierge songeuse, s'insinuent dans les plis de son manteau bleu, de la draperie jaune où s'enveloppe une sainte Anne, sévère comme une Parque, magnifique création du plus beau style. La tendresse qui monte de la nuit baigne les êtres et la nature.”
*Atticisme : Emprunté à la rhétorique et à la littérature, le terme fut proposé par Bernard Dorival puis justifié par Jacques Thuillier pour attirer l'attention sur les qualités élégiaques d'un pan de l'art français et singulièrement de l'art à Paris à l'époque de Mazarin. Pierre Rosenberg évoque en ces termes l'art de La Hyre, Bourdon, Champaigne, Le Sueur : "Ces artistes aiment un faire lisse, sans empâtement marqué, des couleurs claires, juxtaposées avec une audace raffinée, parfois avec une pointe de préciosité, un modelé savant. Ils privilégient la ligne, fuient le mouvement, attachent une grande rigueur à la composition (…)"
Le Sermon sur la montagne

Pour cette commande religieuse, l'artiste Jean-Baptiste de Champaigne - neveu du grand Philippe de Champaigne, et très proche de lui - dut représenter la scène évangélique où Jésus-Christ annonce les Béatitudes, qui sont au cœur de son enseignement. Il lui fallait donc trouver les moyens d'illustrer un événement ancien en soulignant sa portée intemporelle.
Le tableau est le fruit d'une méditation sur l'organisation symbolique des groupes qui figurent une foule. À gauche, la masse statique des douze apôtres, serrés auprès du maître, groupe fermé par le personnage assis en posture calme au premier plan ; à droite, le groupe est moins dense mais plus dynamique : huit personnes figurent la foule attirée par le Christ, et la tension de ce mouvement collectif est soulignée par la pose oblique de l'homme assis à droite. Au centre, l'espace du premier plan est encore dégagé, ce qui invite les spectateurs du tableau à compléter le cercle des auditeurs du Christ ; sa parole, nous dit ainsi le peintre, s'adresse à ses amis, aux foules de son temps et aux générations futures.
Autre tension pleine de sens, entre les deux paysages : la nature paisible et propice à la communion spirituelle de cette colline ombragée (où quelques palmiers veulent rendre oriental un bosquet digne de Poussin) s'ouvre sur un paysage lointain grandiose, fermé par des montagnes fantastiques et travaillé par l'activité humaine : les symboles du paganisme (temples romains) et de la puissance écrasante (remparts, forteresse) y sont prédominants.
Presque au centre géométrique, le personnage de Jésus est campé sur un monticule. Dans son attitude s'opère comme une fusion des deux groupes : la pliure des jambes a le dynamisme d'un mouvement, mais le haut du corps a la plénitude d'une pose stable. Enfin, si tous les regards convergent vers Jésus, le sien voit déjà plus haut et plus loin que notre monde.
Le bleu qui domine dans ce tableau est du lapis-lazzuli. Réputé couleur « froide », il est utilisé dans une gamme étendue. Les deux tons utilisés pour le personnage central sont repris et équilibrés dans le reste du tableau.
Le savoir-faire du peintre met en valeur un symbole fondamental : son tableau est ordonné à partir d'un triangle central incluant le Christ et les personnages les plus avancés de chaque groupe. Il y réunit avec force les trois couleurs primaires : bleu, jaune, rouge. Tout le reste va procéder de cette image symbolique, donnée au regard et à l'esprit.
La fille aînée de l'artiste peignant son frère

Ce très beau tableau avait été attribué par les Magnin à l'anversois Coques, célèbre pour ses portraits de groupe, inhabituels en France au XVIIe siècle. L'œuvre a été rendue à Claude Lefebvre – surtout connu comme graveur - grâce à la description du tableau dans un document anonyme de l'Académie royale de peinture et sculpture. Lefebvre a peint une autre de ses filles, en compagnie de son maître de musique Charles Couperin, dans un tableau conservé au château de Versailles : même splendeur du coloris, même audace dans la mise en page et dans le caractère “instantané” de la représentation, qui font presque penser aux portraits d'un Carolus-Duran, deux siècles plus tard.
Gestes affectueux, bijoux et riches étoffes aux coloris complémentaires relèvent l'éclat et la fraîcheur des personnages. Une atmosphère de calme et de raffinement baigne les figures, dont on aperçoit trois modalités de représentation : de profil (dans le miroir), de trois quarts et de face. Étant donné l'âge des modèles, il est probable que le tableau a été peint dans les dernières années de la brève vie du peintre, vers 1670.
Le fait que plusieurs artistes méconnus de la collection soient également représentés dans les musées de Dole, Dijon et Besançon ne tient peut-être pas du hasard. Jeanne Magnin avait établi le catalogue de leurs peintures. Un portrait de femme avec son fils d'un grand raffinement associé à une délicatesse et une fraîcheur d'expression conservé au musée des beaux-arts de Dole, peut être rapproché de notre tableau.
L'Assomption de la Vierge

Au début des années 1670, Charles de La Fosse obtient un prestigieux chantier religieux comprenant notamment la peinture à fresque de L'Assomption de la Vierge à la coupole de l'église des Religieuses de l'Assomption, rue saint-Honoré à Paris.
L'absence de variantes avec le décor de l'église et la modestie du seul repentir, visible sur le bout des doigts de la main d'un putto au premier plan, obligent à s'interroger sur le caractère préparatoire de ce tableau qui est traditionnellement considéré comme le modèle de la coupole. Il est possible qu'il s'agisse plutôt d'un ricordo – répétition destinée à faire mémoire -, dont l'œuvre de La Fosse offre des exemples.
Cette version de la fresque témoigne des couleurs franches et lumineuses utilisées par le peintre : une dominante de bleu et de vert rompus avec des accents de rouge et de jaune. Les deux groupes d'anges forment des diagonales parallèles, savamment articulées par la lumière qui éclaire les figures en trois endroits pour composer un triangle en haut duquel trône la Vierge, majestueuse, sur fond de ciel d'aurore. La coexistence de ces deux formes géométriques donne un élan que l'on pourrait qualifier de baroque à une composition classique. Les jeux accentués d'ombre et de clarté façonnent les figures en trois dimensions et apportent un effet de profondeur saisissant. Une certaine retenue dans la représentation des draperies, habituellement gonflées et arrondies chez La Fosse, confirme la date relativement précoce de l'œuvre.
« Dans la clarté argentée du coloris, le chatoiement des bleus et des roses annonce déjà, en plein XVIIe siècle, chez un élève de Le Brun, la palette de Boucher. Le parti-pris de joliesse un peu mignarde n'y contredit pas : les grâces mutines, l'abondance et l'allégresse suppléent à l'ampleur du style [...] Tout au plus peut-on critiquer l'aigreur de certains tons rouge vermillon, vert épinard qui pèsent sur l'aimable harmonie et dont on se fût bien gardé au siècle suivant ». (Jeanne Magnin)
La querelle du coloris et du dessin. Charles de La Fosse a été un témoin privilégié du débat entre "rubénistes" et "poussinistes". Sa réception à l'Académie en 1673, qui coïncide avec la fresque de l'Assomption, correspond au sommet de la querelle, et son directorat de l'Académie, de 1699 à 1702, au moment de la toute-puissance des partisans de la couleur. La Fosse n'a semble-t-il pas souhaité prendre une position officielle trop active ; mais les historiens de l'art le rangent unanimement dans le camp des "coloristes" .